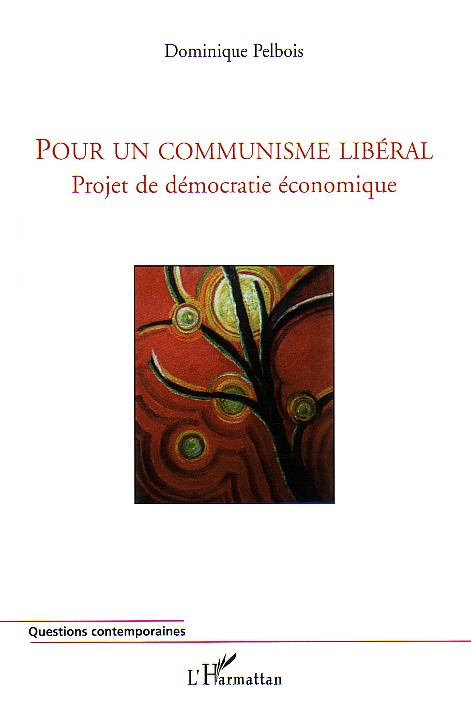Avant de publier mon texte, j'invite d'abord les lecteurs à prendre connaissance d'une autre note de lecture sur le même ouvrage, faite par Les Alternatifs (dont je ne suis pas) : http://www.alternatifs.org/spip/pour-un-communisme-liberal-notes
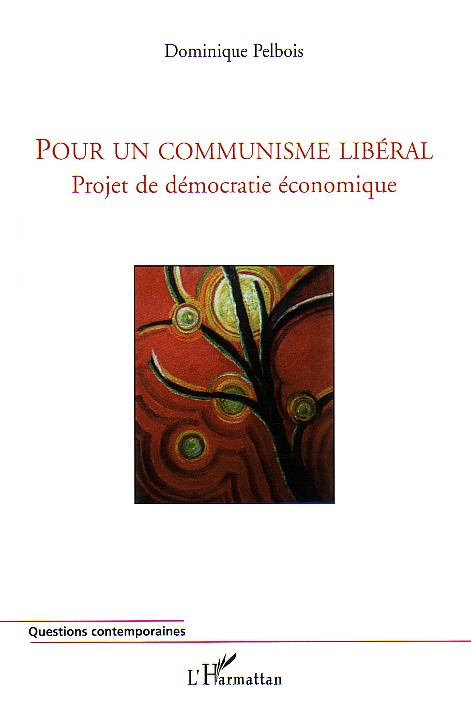
Dominique P. (1947-2003) était un universitaire à formation multiple, notamment en philosophie politique et en économie. Initialement anticommuniste, sa recherche d’un libéralisme social et réellement démocratique l’aurait mené, à la lecture de Karl Marx, sur lequel il a rédigé un DEA (sur les théories de l’exploitation de l’Homme par l’Homme et de la nature par l’Homme), à se rendre compte que ses objectifs étaient compatibles avec ceux du communisme.
Il décida de proposer, dans une thèse déposée à l’Ecole Normale Supérieure, un modèle économique, reposant, comme nous allons le voir, sur un nombre restreint de lois simples, qui, ajoutées à l’économie de marché telle que nous la connaissons, modifieraient profondément celle-ci vers ce que P. a désigné comme le « communisme libéral ».
Deux visions du communisme libéral
Au passage, cette appellation n’est pas du tout pour me déplaire. Et on parle bien de communisme « libéral », pas « libertaire ». Il ne s’agit nullement d’abolir l’Etat, l’armée, la police, de proclamer une anarchie « ordonnée » (l’anarchie, c’est « L’ordre moins le pouvoir » selon Normand Baillargeon). L’économie reste marchande – même si P. entend démontrer que le ressort concurrentiel et chaotique du marché reculera au profit d’une planification spontanément organisée par les agents économiques, sans que l’Etat ait besoin d’en imposer aucune – et la propriété privée n’est pas abolie dans les textes – même si là encore, les règles fondamentales proposées par P. changent profondément son sens.
Ceux qui auront vu mes vidéos de l’Automne 2009 (« Changer de Système ») pourront voir la proximité d’idées existantes entre P. et moi. Je me rattache également à cette famille fort restreinte des « communistes libéraux ». Certains avaient pu trouver le modèle d’économie alternative que je proposais fort compliqué, notamment du fait de l’existence de plusieurs monnaies.
On peut cependant résumer le modèle que j’avais proposé en disant qu’il s’agit d’une économie marchande et concurrentielle où :
- Chaque entreprise qui se crée se voit allouée des crédits illimités dans une monnaie propre aux entreprises, dès qu’une agence (une « banque ») lui en donne l’autorisation ;
- Les mêmes agences éliminent chaque année les entreprises dont le solde (ventes – achats), compte tenu des effectifs de l’entreprise, apparait dans les plus faibles de leur branche de production ;
- Les particuliers reçoivent un revenu dans une autre monnaie, en quantité limitée et à valeur limitée à un an, émise chaque année par l’Etat, la part de chaque individu variant selon des critères socio-économiques (métier, branche où travaille l’individu, niveau du solde de son entreprise) ;
- Les individus peuvent acheter des biens et services aux entreprises, avec la monnaie reçue de l’Etat, aussitôt convertie en monnaie spécifique des entreprises (et donc comptée dans leurs soldes), selon des taux de conversion décidés par l’Etat selon le produit échangé (ce qui ne revient nullement à fixer les prix) ;
- Enfin, il existe une troisième monnaie, « normale » (quantité limitée, durée de valeur illimitée) que les entreprises et particuliers peuvent utiliser pour leurs échanges avec le monde extérieur, les entreprises devant cependant accepter une conversion pour comptabiliser ces échanges dans leurs soldes.
Le modèle de P. apparait plus simple. Les deux lois fondamentales qu’il suggère sont :
- Que l’achat des biens d’équipement lourds par les entreprises soit aboli, et remplacé par le bail ou l’abonnement auprès des fournisseurs ;
- Que tout client d’une entreprise en devienne le sociétaire (client-électeur ou loc-électeur dans le langage de P.), détenant un droit de vote dans la gestion de l’entreprise proportionnel à la valeur de ses achats ;
- Les salariés de l’entreprise en sont également sociétaires (ouvriers-électeurs), détenant un droit de vote proportionnel à leur rémunération (la masse salariale étant normalement inférieure aux recettes totales de l’entreprise, les droits de vote des clients sont toujours majoritaires par rapport à ceux des salariés) ;
- Des caisses de redistribution du pouvoir d’achat, gérées par leurs clients (cotisants), et bénéficaires des prestations (remplaçant les salariés), assumeraient le financement des retraites, des soins de santé, des allocations familiales…puisque selon P., dans ce système, la capitalisation individuelle n’aurait plus de sens.
Cela veut donc dire que, dans l’économie présentée par P., une entreprise n’aurait pas besoin d’avoir de capitaux sous forme de machines, locaux, véhicules, autres instrument de production… Il suffirait de tout emprunter, et dès lors que les recettes de l’entreprise permettent de couvrir les loyers, sa survie économique est assurée. L’entreprise qui loue devient de fait électrice de la direction de son fournisseur. Et inversement, on peut penser que l’entreprise est au moins propriétaire de ce qu’elle produit, à défaut de l’être sur ses outils de production. Mais, en vertu des mêmes règles, lorsqu’elle vend – ou loue – sa production, l’entreprise devient de fait « possédée » par ses clients/abonnés/locataires. Il n’y a donc, selon Dominique P., plus d’accumulation de capital possible, sans pour autant rendre la production impossible.
Les conséquences concrètes du communisme libéral de Dominique P.
Une fois ces quelques règles exposées, le livre expose les conséquences qui en découleraient :
- Les entreprises sont directement au service de leurs clients, mieux que ne le ferait aucune entreprise capitaliste. En même temps, elle a intérêt à ménager ses salariés. Même si ceux-ci sont minoritaires face aux clients, la satisfaction de ces derniers dépend de ce que les premiers aient un haut niveau de productivité, soient formés, et tout simplement à l’aise dans leur entreprise. Les salariés conservent le droit de grève, mais seraient peu tentés de l’utiliser ;
- Les entreprises, si elles sont de petite taille, peuvent être regroupées en une société gérant plusieurs commerces. Les clients, s’ils ne veulent se présenter aux assemblées de clients-électeurs, peuvent toujours être remplacés d’office par un Représentant d’Office des Clients Absents, dont les droits de vote seront égaux au total des votes des clients moins ceux des clients qui se seront déplacés aux assemblées. Ce représentant est élu pour la même durée que le directeur de l’entreprise (élu par les salariés et clients). Mais il a naturellement intérêt à défendre les intérêts des clients absents. Parce que si l’entreprise néglige ses clients, elle risque de voire arriver les clients jadis absents en masse aux assemblées, pour se plaindre, ce qui réduira d’autant le pouvoir du Représentant d’Office ;
- Selon P., l’impossibilité d’accumulation de capitaux privés, et la gestion démocratique des entreprises par leurs salariés et clients, aboutirait à une société globalement égalitaire. Ce qui conjurerait à ses yeux le risque de perversion de l’exercice démocratique par l’existence de classes d’individus aux revenus très différents. Le privilège que confère la fortune privée disparait (puisque la propriété est vidée de son sens au profit du bail) ;
- Parmi les entreprises les plus importantes, en aval de la chaine de production, se trouveraient les gérances immobilières. Que l’on vive en maisons ou en immeubles, les logements peuvent être gérés par une même entreprise, qui a ses salariés (le personnel d’administration, d’entretien, voire des professionnels du bâtiment, des travaux d’intérieur, d’électricité, d’hygiène qui seraient en permanence occupés sur les logements de ladite entreprise, si son parc est vaste), et ses clients (locataires). Dans ce système où les locataires sont de fait collectivement propriétaires, il n’y a plus d’intérêt à chercher à être individuellement propriétaire de son logement. La propriété collective, créant une démocratie directe portant sur les besoins les plus immédiats et concrets, mène à réaliser des économies d’échelle sur l’entretien des biens, qui rendraient peu attirante la propriété individuelle ;
- Ces gérances immobilières deviendraient vite de puissances facteurs d’agglomération des activités, puisque, comme c’est déjà dit plus haut, de nombreuses professions tournent autour du bâtiment, de l’équipement d’intérieur, de la fourniture en eau, électricité, gaz… En tant que clientes de poids – et donc électrices – de nombre d’entreprises, les gérances pourraient exiger que les sites de production se rapprochent des lieux de résidence, et ainsi réduire le clivage résidence / travail…et même l’opposition ville/campagne dénoncée par les marxistes, puisque les gérances pourraient directement contracter avec les agriculteurs pour assurer l’approvisionnement de leurs locataires en produits dont la fabrication serait bien mieux connue et contrôlée de leurs destinataires qu’on ne pourrait l’attendre avec n’importe quel label ou n’importe quelle « traçabilité » revendiquée dans l’économie de marché actuelle.
- Les entreprises formeraient de fait des circuits de planification spontanée de l’économie, et recourraient moins à la mise en concurrence de leurs fournisseurs. D’abord parce qu’en tant qu’électeurs de ceux-ci, les clients auraient intérêt, selon D.P., à consolider leur relation (et leur pouvoir) sur eux, plutôt que jouer la sortie dès que quelque chose les contrarie. Ensuite, parce que les clients-électeurs pourrait directement imposer un plan de production, au niveau d’une entreprise (ce qui n’a en soi rien de très stalinien, toute entreprise planifie sa production), et ainsi s’assurent des ressources sur lesquelles elles-mêmes, entreprises clientes, pourront compter dans les mois ou années à venir. Ainsi s’engendre spontanément une planification verticale (du client vers le fournisseur, du boulanger vers le minotier vers le céréalier etc…). En même temps, les entreprises d’une même branche se partageant les mêmes fournisseurs, et siégeant aux mêmes assemblées, elles ont par la force des choses intérêt à s’accorder sur le partage des ressources produites et mises à disposition des clients qu’elles sont. Et comme ces entreprises clientes ont elles-mêmes des clients qui peuvent être les mêmes d’une entreprise à l’autre, elles sont naturellement poussées à une planification « horizontale », c’est-à-dire une organisation de la production et un partage des ressources entre entreprises produisant la même chose ou produisant des services ou biens substituables (comme l’est le transport aérien par rapport au rail ou à la route) ;
- Pour D.P., le système serait aussi destiné à la réduction du chômage. Les entreprises, ayant intérêt à dégager des prix intéressants pour leurs clients (et donc une productivité supérieure de leurs salariés) et des salaires attrayants pour leurs travailleurs, peuvent dégager des capacités de production nouvelles qui seraient alors disponibles pour employer tout nouvel actif. Les gérances immobilières ne pourraient supporter, de leur côté, d’avoir des logements vacants (sauf ceux mis en réserve en cas de sinistres), et auraient intérêt à les occuper tous, et ensuite à rechercher un emploi pour leurs locataires au chômage, afin d’en faire des clients disposant de droits de vote et enrichissant la gérance ;
- D.P. imagine même d’autres conséquences à plus long terme de cette démocratie économique : les gérants des sociétés immobilières, soucieux de ne pas avoir trop de logements à construire à l’avenir, pousseraient les ménages à recourrir à la planification familiale, pendant que les (futurs) retraités, eux, prôneraient une natalité conséquente, pour leur assurer leurs retraites à venir…
Incertitudes et comparaison des deux modèles
Partant sur un nombre limité de changements radicaux, la réflexion de Dominique P. n’en est pas moins riche. C’est pourquoi, par concision, je traiterai directement les points qui suscitent en moi quelque scepticisme.
L’emprunteur
D’abord, prenons la loi initiale sur l’abolition de l’achat des grands biens d’équipement. La distinction entre les biens d’équipement des particuliers (donc destinés à une consommation finale), et biens d’équipements productifs n’est pas faite. Et on ne précise pas à partir de quel niveau on passe de l’achat à la location. Car il n’est pas vrai que l’on puisse tout emprunter. On peut emprunter des hangars, des usines, des véhicules, parfois des routes, ou des ordinateurs…On peut s’abonner à l’électricité ou à l’eau. Mais peut-on emprunter des fournitures de bureau, des outils manuels, des formations ponctuelles ? L’entreprise doit bien de temps à autres passer de « locataire » à « cliente ». Cela ne change rien, dans le système de règles proposées par D.P. : l’entreprise reste une électrice de ses fournisseurs. Mais la limite entre le passage de l’un à l’autre n'est pas un problème anodin : si l’entreprise peut acheter des biens, il existe quand même une possibilité d’accumulation. Et la même question se pose pour les particuliers, qui peuvent donc quand même constituer un patrimoine.
Pour aller à la racine des lois fondamentales : peut-on vraiment emprunter sans capital initial ? Dominique P.semble le penser. Pourtant cette généralisation du recours à l’emprunt signifie la conservation d’un risque : pour le prêteur, qui peut craindre qu’on lui détruise, dégrade ou ne lui rende jamais son bien, et pour l’emprunteur, qui peut craindre qu’on lui résilie son bail alors que son activité en serait totalement dépendante. Bien sûr, dans le système de D.P., l’emprunteur est également sociétaire de son bailleur… Mais il n’est pas le seul. Et même avec une gestion démocratique, une société bailleuse peut décider de répudier un de ses clients minoritaire. En conséquence, un bailleur demandera, comme c’est le cas actuellement, des garanties sous forme de caution ou d'apport personnel. Un emprunteur pourrait prendre une assurance. C’est l’aspect de la propriété que Dominique P. semble oublier : le risque inhérent au statut de locataire, le rapport de force défavorable que ce statut introduit (même si le bailleur est dirigé par un collectif de locataires). Dans le modèle que j’avais développé, une entreprise étant toujours solvable (même lorsqu’elle a la veille d’être liquidée pour cause de solde trop bas) dès lors qu’elle a reçu l’autorisation d’exercer, ses fournisseurs n’ont pas de craintes sur leurs recettes, et les investissements peuvent toujours être financés, quitte à ce que leur règlement soit différé sur plusieurs années. Les entreprises ont cependant l'obligation vitale d'en faire un usage productif.
L’électeur
Il est aussi une autre question concernant la représentation démocratique : comment représenter les « microclients » ? Lorsque vous achetez une canette de bière dans le supermarché d’une ville où vous serez passé une fois en cinq ans, allez-vous devenir « client-électeur » de cette grande surface ? Et même si j'y faisais mes courses tous les jours de l’année ? Que pèserait ma voix à l’assemblée des clients-électeurs ? Et dois-je me rendre à toutes les assemblées de tous les magasins que je fréquente ? Le problème est que pour un nombre important d’entreprises, les clients seront soit trop occasionnels, soit trop peu nombreux par rapport à l’ensemble. Comment espérer qu’ils tiennent leur rôle d’électeurs ? P. a déjà commencé à répondre en introduisant le Représentant d’Office des Clients Absents. Mais dans la grande distribution, ou tout autre secteur où les clients individuels sont nombreux (téléphonie, distribution d’électricité, eau, gaz…), ce Représentant risque d’avoir beaucoup de voix à représenter. Et de fait, si l’administration se fait trop souvent par procuration, on en revient de fait à une régulation de la production des entreprises par le simple jeu des prix et de la communication, plus que par la démocratie interne. Une autre méthode, sur laquelle l’auteur aurait pu insister, serait la représentation agrégée des électeurs (via des associations de consommateurs de commerces alimentaires) et le regroupement des petits commerces en sociétés de tailles plus conséquentes (point en revanche évoqué par D.P.). Ainsi, chaque consommateur – citoyen n’a plus qu’une poignée d’assemblées auxquelles participer – ou d’associations à choisir.
D’une façon globale, D.P. surestime la démocratie. Les conflits entre majorité et minorité en sont pourtant le fonctionnement normal. De même, la représentation des individus via les associations revient à la même problématique que celle que posent les partis politiques, qui « moyennisent » les demandes des particuliers, et rajoutent un échelon dans les conflits de personnes, de tendances…Et surtout, les partis politiques, c’est leur raison même d’exister, sont en concurrence, et pour cela les associations compteraient sur la concurrence des entreprises où elles sont implantées. Et comme les partis politiques, elles chercheraient à s’allier entre elles pour exclure les minoritaires. Tout comme, dans les situations de pénuries que Dominique P. imagine (au cas où, pas comme un risque général), les assemblées pourraient voter le rationnement des produits d’une entreprise, pour éviter que leurs prix ne montent, et de sacrifier ainsi une minorité de clients.
De plus, les prévisions de long terme comme la régulation de la natalité via les demandes des retraités ou des gérants d’immeubles paraissent angéliques : jamais une démocratie n’a réussi à réguler étroitement la natalité de sa population. Et ce même dans une situation de déficit prévisible et durable du système de retraite, qui imposerait une hausse de la natalité.
Pour en venir au sujet des caisses de redistribution (dont on ne sait pas quelle autorité - à part l'Etat - pourrait imposer d'y aux particuliers d'y cotiser), D.P. considère que les cotisations seraient toujours supérieures aux prestations, assurant la domination des cotisants sur les bénéficiaires. Mais que se passe-t-il si la caisse se retrouve en déficit ? Logiquement, les bénéficiaires domineraient. Et auraient tout intérêt à pressurer encore plus les cotisants, quitte à ce que la caisse fasse faillite…Raisonnement à court terme ? Ce n’est pas rare en démocratie.
L’entrepreneur
Plus généralement, la question de l’autorité sur les entreprises est biaisée dans l’approche de D.P., parce qu’elle oublie le rôle de l’initiative individuelle. Même dans le chapitre sur les innovations, on n’aborde pas la situation où une seule personne crée une entreprise. Est-ce qu’un créateur accepterait de céder automatiquement sa souveraineté au profit de l’ensemble de ses clients ? De ses salariés, peut-être, et c’est ce en quoi consiste mon modèle de socialisme alternatif (où les salaires ne sont pas versés par l'entreprise elle-même, ce qui fait que le dirigeant de l'entreprise n'a pas de pouvoir répressif sur ses employés, la coopération entre ceux-ci et l'entrepreneur venant du fait que leur rémunération versée par la collectivité est proportionnelle au solde de l'entreprise).
Pour conclure, je note que Dominique P. avait décidé de décrire son modèle comme s’il avait été établi depuis longtemps. A l’inverse, j’avais démarré la description du mien justement par l’étape de l’ouverture d’un commerce. Or, quitte à adopter un point de vue « libéral » (quel problème pour un communiste libéral ?), comment envisager l’économie sans la voir en premier lieu (mais pas seulement) comme une histoire d’entrepreneurs ?